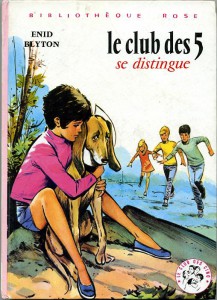Alors que ce week-end est annoncé comme le grand rush des départs en vacances, je repensais hier soir à un souvenir d’enfance étroitement lié à cet événement, souvenir qui me laisse aujourd’hui encore un délicieux sentiment… qui ressemble fort au bonheur.
Lorsque j’étais gamine, les jours d’avant le départ étaient pour moi presque plus magiques que les vacances elles-mêmes.
Deux jours avant, alors que ma mère avait déjà commencé à remplir les valises de la famille, mon père nous réunissait pour nous dire:
– Maman prépare les valises, et vous savez qu’il n’y a pas beaucoup de place dans la voiture. Donc, chacun de vous trois a droit à un petit sac dans lequel vous pourrez mettre ce que vous voudrez emporter pour ne pas vous ennuyer les jours de pluie. Hop! Au travail!
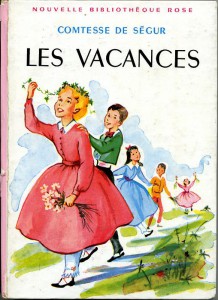 Il est vrai qu’une Coccinelle n’est pas une Picasso grand format…
Il est vrai qu’une Coccinelle n’est pas une Picasso grand format…
Tandis que mes frères se préparaient dans leur coin, je filais réunir mes trésors.
Je commençais par prendre le vieux sac à main de ma grand-mère maternelle, qu’elle m’avait donné alors qu’elle ne s’en servait plus.
Il était très laid, mais avait le mérite d’être grand.
J’y glissais les bricoles dont je savais ne pas pouvoir me passer.
Des mini poupées, un crayon, un taille-crayon, du papier, une vieille boussole, etc…
Je ne le remplissais qu’à moitié, car je savais qu’allait avoir lieu LE moment magique d’avant départ.
En l’attendant, je prenais mon inséparable chien en peluche, Bobby, qui était évidemment de la partie.
A la naissance, c’était un caniche.
J’avais trouvé la « perruque » qu’il portait sur la tête tellement ridicule que je l’avais soigneusement décousue, transformant mon cher Bobby en un chien de race indéfinissable, infiniment plus élégant à mes yeux.
Et quand mes frères se moquaient de moi parce que je l’emmenais, je haussais les épaules.
Il fallait bien quelqu’un pour garder mon sac!
Durant la semaine précédant le départ, Papa ramenait à mes frères des jeux de poche et des magazines qui les ravissaient.
Puis venait mon tour.
Il m’emmenait chez un marchand de journaux libraire.
Là, j’avais le droit de choisir un ou deux jouets pour petites filles.
Des babioles à deux sous qui me ravissaient.
Et, enfin, venait le grand moment.
Nous nous rendions devant le rayon des livres pour enfants, et le rituel du Grand Marchandage commençait.
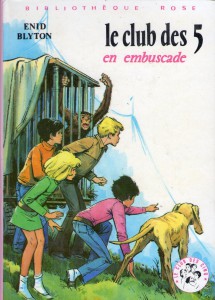 Papa savait qu’il m’était impossible de passer ne fut-ce qu’un jour sans lire.
Papa savait qu’il m’était impossible de passer ne fut-ce qu’un jour sans lire.
Alors deux ou trois semaines… il fallait prévoir une provision conséquente.
Il commençait toujours par une réflexion du genre:
– Voyons… combien penses-tu lire de livres pendant ces vacances? Un? Deux?
– Oh non! Ca, c’est juste pour une semaine!
– Alors trois?
– Mais papa… trois semaines!!
– Mettons quatre et on n’en parle plus. De toute façon, tu ne vas pas passer tout ton temps enfermée dans la caravane!
– Mais… et s’il pleut??
– C’est vrai… Bon. Tu as droit à cinq livres. C’est bien assez pour trois semaines. Maintenant… lesquels?
C’était l’époque où je lisais tous les livres de la Bibliothèque rose et de la verte, raffolant des personnages de la Comtesse de Ségur, du Club des Cinq, du Clan des Sept, d’Alice, de Fantômette…
Je réfléchissais longuement, demandant l’avis de mon père qui jouait le jeu.
Finalement, à la sortie, je me retrouvais sur un nuage, avec… six ou sept livres et un ou deux magazines pour enfants.
Il me conseillait de filer glisser mon butin en douce dans mon sac sans passer par le salon ou la cuisine où se trouvait ma mère.
Lorsque je m’attardais dans le couloir, j’entendais celle-ci lui dire:
– Alors, combien, cette fois?
– Oh, juste ce qu’il faut pour qu’elle ne s’ennuie pas pendant trois semaines!
– Plus de trois?!
– A peine!
– Mais enfin, Paul! Elle ne va pas passer sa vie à lire, quand même!!
Je grimpais ventre à terre dans ma chambre et glissais les livres dans le fond du sac.
Par dessus, je mettais les jouets indispensables et je faisais un nid pour les bébés poupées, histoire qu’ils voyagent confortablement.
Je rajoutais un ou deux petits sachets en plastique pour y déposer les trouvailles m’interpellant sur les bords des chemins, des rivières ou de l’océan.
Puis je tirais de toutes mes forces sur la fermeture éclair pour fermer le sac, sur lequel j’asseyais Bobby, gardien du trésor.
Le soir précédant le jour J, je rêvais à ces livres que j’allais pouvoir déguster sous un arbre ou sur un rocher, ou, mieux encore, dans un coin de la caravane toilée, tout en écoutant la pluie.
Au moment de s’installer dans la voiture, je filais dans mon coin, derrière le siège de mon père, mon sac et Bobby sur les genoux.
Je savais que, dans quelques kilomètres, j’allais être malade… mais ces bouquins qui m’attendaient me donnaient tous les courages!
Martine Bernier